
HUIT FOIS PAR ANNÉE, NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF CONSACRERA QUELQUES LIGNES À L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE D'UN AUTEUR OU D'UNE AUTRICE D'ICI DONT ELLE A FAIT LA DÉCOUVERTE, OU DONT ELLE JUGE QUE LE TRAVAIL DEVRAIT ÊTRE DAVANTAGE CONNU...

HUIT FOIS PAR ANNÉE, NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF CONSACRERA QUELQUES LIGNES À L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE D'UN AUTEUR OU D'UNE AUTRICE D'ICI DONT ELLE A FAIT LA DÉCOUVERTE, OU DONT ELLE JUGE QUE LE TRAVAIL DEVRAIT ÊTRE DAVANTAGE CONNU...
Le labyrinthe du temps passé, avec ses innombrables galeries, a pris peu à peu dans ma tête la forme d’une mine. Et le génie minier, dont j’ai une connaissance rudimentaire, me donnait du courage, tandis que son vocabulaire technique, que je connaissais dans les grandes lignes, m’aidait à m’orienter dans tout ce noir, dans les profondeurs de la mémoire infestées d’espèces inconnues mêlées à tant de visages familiers.
Tout commence à Highwater, au Québec, près de la frontière américaine. Mais il s’agit d’une Highwater recréée par les souvenirs d’une mystérieuse narratrice… et d’une intrigue à l’image des ramifications souterraines de la mémoire, sombres, inquiétantes et séduisantes à la fois.
Dans ces galeries, le temps est horizontal.
Ainsi embarquée dans l’œuvre foncièrement singulière qu’est celle d’Olga Duhamel-Noyer, j’ai été ensorcelée par le périple dans le dédale des souvenirs de l'héroïne, où se croisent la défunte et bien-aimée chienne Sud, et l’amante Venise, à diverses époques…
Je pelais des fruits, je débitais en quartiers une belle pastèque et je dévorais du regard Venise, des années plus tôt, qui attendait dans la marina d’une petite ville.
… et dans des villes à la fois étranges et familières qui ressemblent à des corps malades.
Les contours du corps pouvaient être un modèle pour nommer le monde extérieur. Ainsi, on parlait du « cœur » de la ville, de ses « poumons », etc. Et tout le dédale des égouts sous la terre, ça faisait les intestins ; ces longs boyaux, ces larges collecteurs, les fosses septiques des campagnes. On suivait certaines nuits des marécages nauséabonds. À perte de vue. Quelquefois, la fermentation était si intense dans les zones sombres de la tête et dans les campagnes lointaines, dont l’image reste figée et comme irréelle dans mon souvenir, qu’il me semblait très nettement entendre les remous de cette patiente fermentation.
Il va sans dire qu’en refermant le roman, je n’avais qu’une envie : plonger dans la suite. La suite dont le titre porteur attise la lectrice qui se trouve en plein sevrage des galeries souterraines de Highwater : Destin.
*
J’essaie de rendre compte de ce qu’a été pour moi la traversée des romans d’Olga Duhamel-Noyer, de Highwater à Une autre vie est possible en passant par Destin, Le rang du cosmonaute et Mykonos. Une sorte de mimétisme s’empare de moi. Comme si j’avais été hypnotisée par cette rencontre avec une œuvre, une voix, une manière, un style et un univers si singuliers, que mes mots étaient condamnés à danser autour.
Autour de ces lieux. De ces ambiances chargées comme des vagues prêtes à se briser et à tout détruire. De ces mondes, du plus étrange au plus reconnaissable. Du plus cauchemardesque au plus dangereusement paradisiaque. Du plus lunaire au plus familier.
Ce billet sera sans doute à l’image du voyage que je viens de faire. Pourquoi pas.
*
… j’attendais la suite de mon destin.
Dans Destin, un enfant « grandit, évolue, se perd, se retrouve, jusqu’à la naissance d’un autre enfant ». C’est l’histoire des détours que peut prendre une existence pour arriver à son point d’équilibre. L’enfant devient jeune femme, puis femme, puis parent, dans une famille réunissant son amante, le père biologique, et l’enfant qu’ils élèvent tous les trois. On est dans les années 80 et 90 et les personnages sont traversés par les grandes questions de l’époque, SIDA, éclatement de la famille traditionnelle, homophobie, rapports coloniaux tordus entre les deux pays de la narratrice, le Québec (dont elle est originaire) et la France (où elle a vécu longuement).
On se tournait parfois vers moi en voulant me faire parler de l’endroit d’où je venais qu’ils appelaient « Canada », et moi je disais une chose ou une autre avec indifférence, parce que mon pays m’était en vérité indifférent. Je répétais des choses convenues, qui me paraissent néanmoins justes encore aujourd’hui : « Là-bas, quand même, on a le sentiment que tout est possible. » Ensuite, venait le moment où l’on charriait l’aspiration à l’indépendance de beaucoup de Québécois et où l’on me parlait de l’Europe, du mouvement des peuples aujourd’hui, de la mondialisation, on me disait toujours les mêmes choses, qui reflétaient toujours la même ignorance...
Les humains changent mais le monde, lui, a du mal à suivre…
Le destin de la petite famille que formeront les personnages de Destin, hors normes et hors prescription, hors tradition, hors convenances, n’en est pas moins profondément enviable. Ils trouvent une paix à l’encontre de la fureur du monde.
*
Dans Le rang du cosmonaute, Youri, surnommé « le cosmonaute » par les gens de son coin natal, est revenu y vivre après des années d’absence. Ici aussi, les temps se confondent et se chevauchent dans une sorte de monde multi temporel d’une grande beauté. Il y a le présent de Youri, son passé en ces lieux, mais aussi le futur que promettait le passé, avec ses rêves de conquête de l’espace et sa fascination pour les étoiles et autres planètes. Tout cela, tissé pour créer cet univers dont on a l’impression qu’il est tout ensemble réaliste, lunaire, post-apocalyptique, étonnant. Youri voyage dans son propre passé et dans le futur dont il rêvait autrefois...
Il est le fils de générations d’aventuriers, petits et grands, partis de chez eux pour tenter leur chance. Et pendant que beaucoup de ces descendants d’aventuriers travaillent de génération en génération à s’établir ici, à inventer dans l’exaltation la beauté d’ici, parmi les conifères, les tempêtes, l’âpreté d’un territoire à organiser, d’autres individus à travers les siècles poursuivent le rêve de partir encore et toujours, celui de partir sans jamais regarder derrière. [...]
… pour finir par se libérer peut-être pas de l’attraction terrestre, mais davantage de l’attraction de la terre (natale).
Plus que jamais il est habité par cette phrase gravée sur la lame de son couteau de chasse : La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau.
Oui, ça se termine sur cette phrase magnifique. Le rang du cosmonaute nous parle, lui aussi, de liberté. Celle d’occuper ou de quitter les territoires du monde et de la mémoire.
*
Mykonos est peut-être bien l’un des romans les plus dérangeants que j’aie lus. Ici aussi, une sorte de magie noire semble à l’œuvre. Celle du style sobre, mesuré d’Olga Duhamel-Noyer, celle de son sens des descriptions, et de sa capacité à créer une ambiance inquiétante, porteuse d’une tragédie en train de se préparer dans un décor qui devrait être paradisiaque, habité par des corps festifs, parfaits.
Quatre jeunes hommes, Christopher, Sebastian, Jules et Pavel, passent une semaine à Mykonos. Ils sont beaux et pas très préoccupés – à l’exception de l’un d’eux, peut-être. Ils sont d’une superficialité tantôt touchante, tantôt agaçante.
Les garçons ont pris un autobus pour Paradise Beach. Là-bas, ils ont nagé jusqu’aux rochers et se sont fait sécher contre les pierres chaudes. Ils ont aussi plongé, fait la course et dormi sur leurs serviettes. Des pin-up jouent au ballon devant eux. La veille, d’autres pin-up faisaient les mêmes gestes autour du filet, alors que d’autres jeunes hommes nageaient sauvagement le crawl avant de s’affaler sur leurs serviettes.
Il y a quelque chose ici de la répétition obsédante du faux, du clinquant, de l’inconscience crasse d’une certaine jeunesse occidentale, qui n’est peut-être pas pour peu dans cette impression tenace que quelque chose de grave va arriver.
Tout se passe comme si jour après jour les mêmes chorégraphies revenaient sur le sable.
Car si les héros comme les autres personnages et même les figurants, ces autres vacanciers, l’oublient, moi, lectrice, j’avais aussi sous les yeux l’envers du décor. L’envers du faux.
Les toilettes sont à l’arrière du Tropicana. Une haie de lauriers-roses cache un chemin de terre. En traversant les lauriers, on bascule dans l’envers du décor. Sur les branches des buissons très secs, du papier de toilette rose et des sacs de plastique sont restés accrochés. Des bouteilles vides par dizaines ont été jetées derrière les buissons. Le soleil est loin d’être couché encore et les danseurs sont nombreux de l’autre côté.
Et tout au long du roman, lancinante, et criminelle à cause de cette certitude que ce n’est pas grave, que c’est léger, que c’est pour rire, gronde l’homophobie de nos sociétés soi-disant modernes, nanties, éduquées…
C’est ce que pressent Dimitri, barman qui a l’habitude de frayer avec les touristes et de se protéger, mais qui a le malheur, un jour, de croire ne serait-ce qu’un instant que l’expression la plus simple de ce qu’il est et l’aveu de son attirance pour un des héros ne causeront pas sa chute. Car ces garçons qui viennent étaler leur indolence au soleil, derrière cette insouciance, cette arrogance des privilégiés, sont dangereux.
Ils aimeraient mettre son désir dans un tout petit enclos.
*
L’homophobie est aussi évoquée dans Une autre vie est possible. On y retrouve Valéry et sa mère, Micheline, chef de cellule du parti communiste. Micheline et ses camarades militants rêvent de révolution, mènent des actions auprès de concitoyens démunis, qui ne les comprennent pas toujours, et discutent de longues heures de leurs espoirs.
De manière générale, être communiste signifie tendre vers un idéal. Ne pas se contenter du confort moderne. S’échiner à faire advenir un monde plus juste.
Tout au long du roman s’esquisse un portrait à la fois lucide, tendre et sans complaisance de ce que sont le militantisme, l’engagement. Leurs limites mais aussi leur beauté. À aucun moment l’autrice (ou ses personnages) ne se leurre sur le chemin (infini) à parcourir entre ce vers quoi l’on veut tendre, et le lieu où, collectivement, on se trouve.
Les riches ont peur de tout perdre au profit d’idées farfelues et les plus pauvres sont affolés par la crainte que ces militants qu’ils détestent ne leur ravissent les quelques économies qu’ils sont parvenus à amasser. […] La foule ne veut pas perdre le peu de confort qu’elle possède enfin pour satisfaire les idées creuses d’une poignée d’enfants gâtés, influençables et qui ont la belle vie.
La « belle vie » est cependant toute relative. Car dans le cas de deux des femmes du roman, dont Micheline, la violence conjugale viendra tout briser.
La violence conjugale viendra couper le souffle aux femmes qui la subissent, cassant leur élan, les reléguant dans un « mode survie » qui ne permet plus de s’engager dans les luttes du monde social.
Pourtant, ces femmes étaient fortes. Exceptionnelles. Apparemment inarrêtables.
Elle n’a peur de rien. Sauf du malade qui ne la lâche pas.
Les commentateurs ont beaucoup retenu, avec raison, l’irruption de cette violence et l’impuissance des femmes devant elle, soudain réduites au rang de victimes. Victimes de la volonté des hommes qui forcent l’intime à prendre le pas sur le combat, sur le professionnel, sur tout le reste.
Mais il y a autre chose, de plus complexe encore, dans le roman, qui ne fait pas que raconter un renoncement forcé. Il y a, il me semble, un appel à ne pas abandonner cette idée des militants dont nous est racontée l’histoire : tendre vers, bien que l’objectif semble inatteignable. Tendre vers, toujours, parce qu’autrement, à quoi bon exister?
Et quand on referme le roman, quelle que soit la violence, intime ou publique, que le monde met en travers de la route de tous ceux (dans le livre et dans la vraie vie) qui croient qu’une autre vie est possible, on sent s’agiter en soi quelque chose dont on avait presque oublié la présence. Quelque chose comme le désir renouvelé, ragaillardi de tendre vers.
Si ce n’est pas ça, la grande littérature, je ne sais pas ce que c’est.
Mélikah Abdelmoumen
Les romans d’Olga Duhamel, chez Héliotrope :
Highwater, 2006
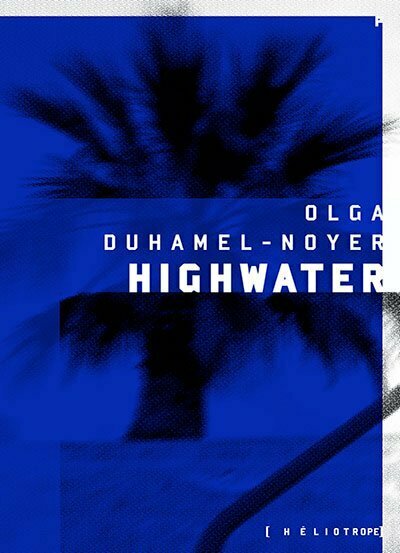
Destin, 2009
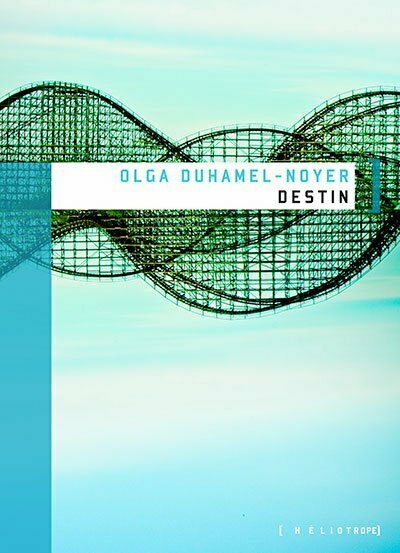
Le rang du cosmonaute, 2014
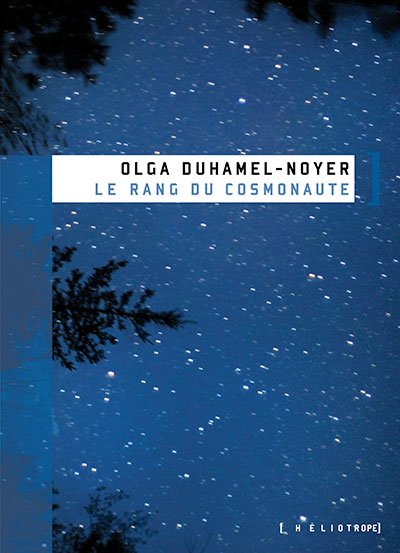
Mykonos, 2018

Une autre vie est possible, 2021

*Photo d'Olga Duhamel-Noyer par Valérie Lebrun.

